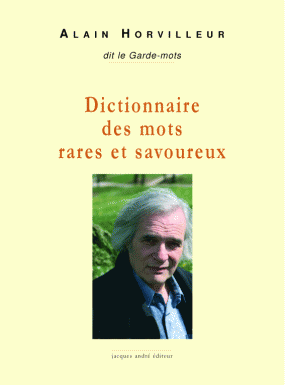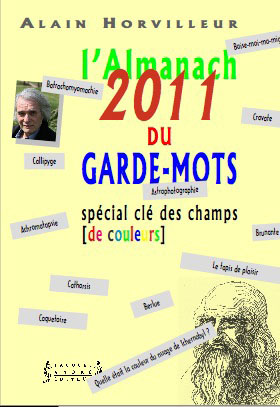« Le rêve est une seconde vie. Je n’ai
pu percer sans frémir ces portes « d’ivoire ou de corne qui nous séparent du
monde invisible. Les premiers « instants du sommeil sont l’image de la mort ;
un engourdissement nébuleux « saisit notre pensée, et nous ne pouvons
déterminer l’instant précis où le « moi, sous une autre forme, continue l’œuvre
de l’existence. C’est un « souterrain vague qui s’éclaire peu à peu, et où se
dégagent de l’ombre et de « la nuit les pâles figures gravement immobiles qui
habitent le séjour des « limbes. Puis le tableau se forme, une clarté nouvelle
illumine et fait jouer ces « apparitions bizarres : le monde des Esprits
s’ouvre pour nous. »

Tel est le début d’
Aurélia ou le rêve et la
vie (1855), la dernière œuvre de Gérard Labrunie dit Gérard de Nerval
(1808-1855). Il l’a rédigée en grande partie dans la maison de santé du docteur
Émile Blanche où il reçut des soins à plusieurs reprises. Il dit lui-même qu’il
donne dans ce texte « les impressions d’une longue maladie qui s’est
passée tout entière dans mon esprit. » Il s’est suicidé avant de l’avoir
achevée.
Dans ce long poème en prose il part à la recherche de sa bien-aimée, la
cantatrice Jenny Colon, rebaptisée Aurélia pour les besoins de la littérature,
morte en 1842, et qu’il a aimée d’un amour platonique. En rêve il la transforme
en mère universelle, ce qui n’a rien d‘étonnant quand on sait qu’il a perdu sa
mère à l’âge de deux ans. La mort d'Aurélia représente pour lui « l'épanchement
du songe dans la vie réelle », ce qui lui permet de s’aventurer en terre
inconnue, c’est-à-dire au sein de son propre mental, fait de mysticisme et de
culpabilité, et de décrire des hallucinations qu’il prend pour la réalité. Les
frontières entre le délire et lucidité sont incertaines et c’est ce qui fascine
dans ce récit autobiographique,
parangon de l’
onirisme en littérature.