Éristique
Par le gardien le lundi 14 novembre 2011, 00:00 - Singumots - Lien permanent
Le terme ne doit pas être confondu avec heuristique, la science qui étudie la découverte des faits.
Euclide de Mégare (v. 450-v. 380 av. J.-C.), disciple de Socrate, est le fondateur de l’École mégarique, dite « éristique » car la science du raisonnement y dégénérait en dispute. On y attaquait Aristote sans développer de doctrine véritable.
Dans Euthydème Platon (v. 424- v. 348 av. J.-C) écrit sur l’éristique. Le personnage éponyme, Euthydème, et son frère Dionysodore sont des spécialistes des raisonnements fallacieux et trompeurs, c’est-à-dire des sophistes. Platon pratique l’ironie à leur encontre.
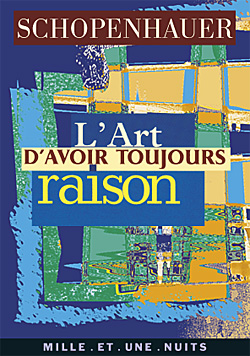 Autre champion
de l'éristique : Arthur Schopenhauer (1788-1860) qui dans L'art
d'avoir toujours raison, publié à titre posthume en 1864, vise non pas à
établir la vérité objective mais son apparence. Il s’agit, pour lui, de
s’affirmer plutôt que de faire prévaloir une vision objective du monde.
Dans ce but il retient un certain nombre de stratagèmes : exagérer les
affirmations de l’adversaire, utiliser l’homonymie et la généralisation pour
détourner l’affirmation vers une signification non prévue, faire semblant
d’admettre la position de l’autre pour mieux la combattre, mettre l’adversaire
en colère, faire diversion, etc. « Ce qui importe, ce n’est pas la vérité mais
la victoire » écrit Schopenhauer. Faut-il prendre au premier degré cette
apologie de la mauvaise foi ? Non, car l’éristique permet également de se
défendre contre les thèses erronées.
Autre champion
de l'éristique : Arthur Schopenhauer (1788-1860) qui dans L'art
d'avoir toujours raison, publié à titre posthume en 1864, vise non pas à
établir la vérité objective mais son apparence. Il s’agit, pour lui, de
s’affirmer plutôt que de faire prévaloir une vision objective du monde.
Dans ce but il retient un certain nombre de stratagèmes : exagérer les
affirmations de l’adversaire, utiliser l’homonymie et la généralisation pour
détourner l’affirmation vers une signification non prévue, faire semblant
d’admettre la position de l’autre pour mieux la combattre, mettre l’adversaire
en colère, faire diversion, etc. « Ce qui importe, ce n’est pas la vérité mais
la victoire » écrit Schopenhauer. Faut-il prendre au premier degré cette
apologie de la mauvaise foi ? Non, car l’éristique permet également de se
défendre contre les thèses erronées.

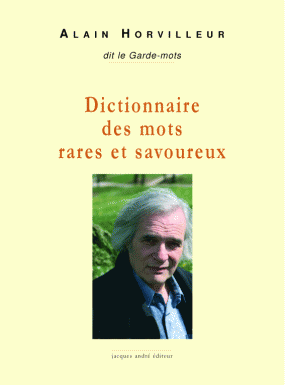
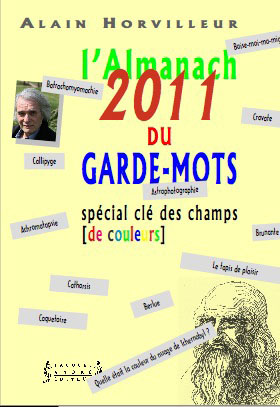


Commentaires
Je ne me sens pas convaincu par vos tentatives d'éristique.
Bonjour Monsieur le Gardien,
Ce mot appelle forcément un commentaire, et sans conteste, il est pratiqué par certaines professions que je tairai, et parfois de manière délicieusement irrationnelle.
Je recherche à ce sujet une petite BD d'Hagar DUNOR de Richard BROWNE sur ce sujet, que je vous envoie si je la retrouve.
Merci de nous donner envie de (re)lire Schopenhauer, qui adorait les femmes en plus....
Bien sincèrement
Comme je n'aime pas me faire manipuler ce mot ne pouvait que tomber, un jour, dans mon escarcelle.
rebonjour
grâce à vous j'ai couru à la librairie pour acheter ce petit livre.merci!
j'apprends donc que "philosophiquement l'on traite les thèses en fonction de la vérité et que, dialectiquement, cela se fait en fonction de l'apparence ou de l'approbation, ou de l'opinion des autres".
ce qui confirme, de manière un peu générale, que les personnes auxquelles je songeais pratiquent objectivement la dialectique et parfois l'éristique, selon qu'ils aient, ou non, la nuque raide comme dirait St Paul.
mais assez de verbiage, et merci de votre réponse.
La vérité c'est dangereux et attrayant...
Merci Garde, par cet intersante billet. Nous savons déjà, dans cette époque qui on vit, lequel est le metier plus "spécialisée" en éristique. Il nous suffit de lire le journal, d'allumer la téle ou la radio pour trouver un master de l’art des raisonnements spécieux et des arguties sophistiquées.
" La femme est un animal à cheveux longs et à idées courtes"
@ hermès
Je me demande si vous parlez sérieusement ou c´est une ironie la "adoration" que Schopenhauer avait pour les femmes.
à la question de "ana":
c'est ironique, enfin, je crois.
prenez-le au 7ème degré.
Si vous aviez dit au 7ème étage, je penserais qu'elle vit là-haut, l'ironie, mais 7 ème "degré” ... je ne sais pas que penser.
(Je plaisante, je ne comprends pas l'expression. Désolée.)
Saludos, Ana
[Pour info, Ana est mexicaine. Le gardien]
L'expression est difficile à expliquer. D'habitude on parle de deuxième degré : il ne faut pas prendre ce qu'on dit tel quel, mais deviner, d'après le contexte, ce qu'il y a derrière. Hermès parle ironiquement du 7e degré pour dire que la résolution de l'énigme est bien cachée.
Quand on a soi-même raison on convainc les gens de bonne foi.
monsieur le Gardien
merci des commentaires 13 et 15, je les partage.
pour conclure disons que "pour convaincre, il faut être convaincu".
à bientôt
Très gentil Garde, merci.
Je crois que j'ai compris, alors j'essaierai d'écrire quelque chose que je crois, je crois seulement que c´est vrai :
"Arthur Schopenahauer était un misogyne au premier degré" . Sourires.
Ce n'est pas un syllogisme mais de l'ironie.
Non, dans un syllogisme il faut trois éléments.
Non un syllogisme, c'est en trois parties :
(1) Tout individu qui dit "T'es con ou quoi?"... est con.
(2) Tu as dit "T'es con ou quoi?"...
(3) Tu es con.
Celui qui est drôle nous fait rire
Le Gardien nous fait rire
Le Gardien est drôle.
Voilà!
Oui c'est de l'éristique puisque vous cherchez à nous convaincre.
Le serpent qui se mord la queue c'est l'ouroboros.
Olala! tous ces syllogismes m´ont rappelée mon (odieux) professeur de logique du baccalauréat. Il nous faisait réciter par coeur, en face de toute la classe, comme si on était des petites "Chaplins":
Barbara, celarent, darii, ferio
Darapti, disamis, festino, baroco
Bamalip, camenes, dimantis, fesapo y fresison
C´est un vrai grommelot, n´est-ce pas Garde?
Le type serait fier de moi, du fait que je me rappelle tout ça après mille années.
Oui, ana, c'est du grommelot.
1-"Quand on a soi-même raison on convainc les gens de bonne foi."
2-Ce soir je suis de bonne foi et tout à fait d'accord avec vous.
3-Donc vous êtes un con vaincu "soi-même".
1bis-La bêtise c'est conclure.
2bis-Flaubert conclut.
3bis-Flaubert est bête.
(Ironie du syllogisme)
Merci pour cette philosophie de comptoir.
De rien. CQFD